
Lyndon Johnson (1908-73) fut président des États-Unis de novembre 1963 jusqu'à sa retraite en janvier 1969. Sous le prédécesseur de Johnson, John F. Kennedy, les États-Unis avaient progressivement accru leur implication au Vietnam, sans toutefois atteindre l’objectif d’une action militaire directe. Comme Truman et Eisenhower avant lui, l’objectif de Kennedy avait été d’arrêter la marche du communisme vers le sud en Asie. Lors de son discours d’investiture en janvier 1961, Kennedy a promis au monde que l’Amérique « paierait n’importe quel prix, supporterait n’importe quel fardeau, affronterait n’importe quelle épreuve, soutiendrait n’importe quel ami… pour assurer la survie et le succès de la liberté ». Pourtant, l'approche de Kennedy en Indochine était mesurée. Au cours des mille jours de sa présidence, Kennedy a augmenté le financement de Saigon, souhaitant développer et renforcer l'armée sud-vietnamienne. Il a également augmenté le nombre de conseillers et d’entraîneurs militaires américains de quelques centaines à environ 12,000 1963 en XNUMX, bien que Kennedy ait résisté aux appels à une implication militaire directe des États-Unis en Indochine.
La présidence de Kennedy est peut-être mieux connue pour sa fin tragique. En novembre 1963, le président effectua une visite officielle au Texas. Il était accompagné de l'épouse de Kennedy, Jacqueline, et du vice-président Lyndon Johnson. La visite était un édulcorant politique, destiné à accroître la popularité de Kennedy au Texas, un État farouchement conservateur que le ticket Kennedy avait à peine remporté en 1960, même si Johnson lui-même était Texan. Le 22 novembre, Kennedy atterrit à Dallas et s'adressa à une réception civique avant de monter à bord d'un cortège. Alors que la limousine à toit ouvert de Kennedy traversait les rues de Dallas, des coups de feu ont été tirés dans sa direction. Kennedy a été touché dans le haut du dos, puis à la tête. La deuxième blessure lui a brisé le crâne et l'a tué presque immédiatement. Le gouverneur du Texas, John Connally, qui se trouvait à l'avant de la voiture de Kennedy, a également été blessé à la poitrine, au poignet et à la jambe. Le vice-président Johnson, qui se trouvait dans une autre voiture, n'a pas été touché ni blessé. À la mort de Kennedy, Johnson devient le 36e président des États-Unis. Il a prêté serment deux heures après le meurtre de Kennedy, lors d'un vol de retour à Washington.
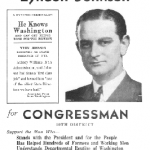
Lyndon Johnson – ou LBJ, comme on l'appelait largement – est né dans une petite ferme du Texas en 1908. Il a obtenu son diplôme d'études secondaires et a poursuivi ses études à l'école des enseignants, où il a été actif dans les débats, la prise de parole en public et la politique étudiante. En 1927, Johnson, 19 ans, accepta un emploi dans une école à classe unique dans le sud du Texas, enseignant principalement à des étudiants hispanophones issus de milieux pauvres. C'est dans ce contexte que Johnson a développé une conscience sociale aiguë et un désir d'améliorer les opportunités pour les minorités et les défavorisés. Comme son père avant lui, Johnson s’est rapidement impliqué dans la politique. En 1937, il fut élu à la Chambre des représentants des États-Unis. Il y servit jusqu'en 1949, date à laquelle il fut transféré au Sénat.

Johnson avait la réputation d'être un politicien honnête et pragmatique, qui disait ce qu'il pensait et était désireux de faire avancer les choses. Bien qu’il soit originaire d’un État conservateur du Sud, sa véritable passion était la réforme intérieure. Johnson rêvait de créer ce qu’il appelait la « Grande Société », en utilisant la richesse américaine pour lutter contre la pauvreté, le déficit de logements sociaux, les lacunes de l’éducation publique et la pénurie d’emplois. Johnson était passionné par la fin de la discrimination raciale, en particulier dans son sud natal. Comme Kennedy avant lui, Johnson était également un anticommuniste et un partisan de la « théorie des dominos ». Quelques jours après son entrée en fonction, Johnson a réaffirmé l'engagement de son pays envers le gouvernement et le peuple du Sud-Vietnam. De son propre aveu, le nouveau président était moins informé et probablement moins intéressé par la politique étrangère que par les questions intérieures. Mais il avait beaucoup voyagé, était profondément conscient de l’histoire et suffisamment astucieux pour comprendre que la situation au Vietnam était critique. Il l'explique dans ses mémoires, écrits en 1971 :
«Je savais depuis le début que je devais être crucifié de toute façon. Si je quittais la femme que j'aimais vraiment - la Grande Société - pour m'impliquer dans cette garce de guerre à l'autre bout du monde, alors je perdrais tout chez moi. Tous mes programmes. Tous mes espoirs pour nourrir les affamés et abriter les sans-abri. Tous mes rêves sont de fournir une éducation et des soins médicaux aux bruns et aux noirs, aux boiteux et aux pauvres. Mais si je quittais cette guerre et laissais les communistes prendre le contrôle du Sud-Vietnam, alors je serais considéré comme un lâche et ma nation serait considérée comme un apaisant, et nous trouverions tous les deux qu'il est impossible d'accomplir quoi que ce soit pour qui que ce soit dans le monde entier. . »
La prise de décision de Johnson concernant le Vietnam a été fortement influencée par les conseils d’experts en politique étrangère et de chefs militaires. Au début de 1964, ces conseillers étaient parvenus à un consensus : les communistes d’Indochine pourraient être vaincus à court et moyen terme, si les États-Unis s’impliquaient plus directement. Selon eux, une combinaison d’intervention militaire américaine, de bombardements aériens soutenus et d’offres de paix répétées les forcerait à se rendre et à se retirer au Nord-Vietnam. Une fois les communistes maîtrisés, a-t-on conseillé à Johnson, le Vietnam évoluerait comme deux États politiquement distincts, tout comme la Corée l'avait fait après l'armistice de 1953. Cette stratégie a été articulée par le secrétaire à la Défense. Robert McNamara et approuvé par l'état-major militaire, d'autres membres du cercle restreint de Johnson et de nombreux membres du Congrès. Mais il y avait aussi des voix de discorde et de désaccord. L’un des plus bruyants était le sous-secrétaire d’État George Ball, critique de longue date de l’action militaire au Vietnam. Dès l'élection de Kennedy en 1960, Ball déconseilla fortement toute implication directe des États-Unis, préférant une politique « sans lien de dépendance ». En 1961, il eut une conversation avec McNamara et d'autres responsables :
«Nous ne devons pas engager de forces au Sud-Vietnam, sinon nous nous retrouverions dans un conflit prolongé, bien plus grave que la Corée. le Viet Cong étaient méchants et durs, comme les Français l'avaient appris à leur grand regret, et il y avait toujours danger de provoquer une intervention chinoise comme nous l'avons fait en Corée. Le problème du Vietnam n'était pas de repousser une invasion ouverte mais de se mêler à une situation révolutionnaire aux fortes connotations anticolonialistes… Dans cinq ans, nous aurons trois cent mille hommes dans les rizières et les jungles, et ne les retrouverons plus jamais, il a prévenu le président. Ball a également souligné le précédent de la défaite française au Vietnam. Kennedy ne semblait pas impressionné par les arguments de Ball: «George, tu es juste plus fou que l'enfer. Cela n'arrivera tout simplement pas ».»
«Le rapport de McNamara a confirmé tout ce que LBJ avait entendu sur l'Asie du Sud-Est. Le Laos pourrait tomber aux mains des communistes d'un jour à l'autre, et le gouvernement du Sud-Vietnam pourrait s'effondrer du jour au lendemain. De toute évidence, la politique américaine est passée de la pagaille à la catastrophe. Johnson savait qu'il devrait, tôt ou tard, décider si les États-Unis allaient plus loin ou en sortiraient. Pour Johnson à la fin de 1963, toute décision pouvait affecter l'élection de 1964. Il voulait se présenter et il voulait gagner. Mais la question était: est-ce que la guerre dans ce «maudit petit pays de fourmis» exploserait en catastrophe électorale et briserait toute sa campagne? »
Frank E. Vandiver
Les opinions du président sur le Vietnam étaient contradictoires. Johnson a accepté le Théorie des dominos et, comme d’autres de son âge qui avaient vécu les années 1930, il se méfiait des dangers de l’apaisement. Il a accepté les conseils de ses généraux, qui lui ont dit que le conflit vietnamien était gagnable à court et moyen terme. Au début de 1964, il déclara à un auditoire que « si nous quittons le Vietnam demain, nous combattrons à Hawaï et la semaine prochaine, nous devrons nous battre à San Francisco ». Mais Johnson était également préoccupé par l’élection présidentielle prévue en novembre 1964. Il savait très bien qu’engager les troupes américaines dans une autre guerre étrangère au cours d’une année électorale serait un suicide politique – et que perdre les élections signifierait la fin de ses réformes de la Grande Société. À Noël 1963, Johnson aurait dit aux commandants militaires et aux faucons de son administration : « Faites-moi simplement élire et vous pourrez alors mener votre guerre ». Bien qu'il ait soutenu ses conseillers, Johnson a admis avoir des doutes persistants quant aux perspectives militaires américaines au Vietnam. Il a demandé à plusieurs reprises des conseils et des assurances sur le fait que le Nord-Vietnam était incapable de rivaliser avec l’escalade américaine. Même en septembre 1964, quelques semaines après le Incident du golfe du Tonkin, Johnson a demandé à ses conseillers si «le Vietnam valait tous ces efforts».

1. Lyndon Baines Johnson était un enseignant devenu politicien du Texas. Il est devenu vice-président de John F. Kennedy et président après l'assassinat de Kennedy en novembre 1963.
2. Le programme principal de Johnson était la réforme sociale. Il espérait construire ce qu'il appelait la Grande Société en entreprenant des réformes radicales pour éliminer la discrimination et la pauvreté.
3. Comme d’autres de son époque, Johnson était également anticommuniste. Il était un avocat de la doctrine Truman, de la théorie des dominos et de la nécessité de contenir le communisme asiatique.
4. Johnson était moins informé de la politique étrangère que des questions intérieures. Il a beaucoup fait appel à des conseillers militaires, qui lui ont assuré qu'une campagne contre le Nord-Vietnam réussirait.
5. Johnson a finalement accepté d'escalader l'armée américaine au Vietnam, mais pas avant l'élection présidentielle de novembre 1964.
© Alpha Histoire 2018. Le contenu de cette page ne peut être republié ou distribué sans autorisation. Pour plus d'informations s'il vous plaît se référer à notre Conditions d’utilisation.
Cette page a été écrite par Jennifer Llewellyn, Jim Southey et Steve Thompson. Pour référencer cette page, utilisez la citation suivante:
J. Llewellyn et al, « Lyndon Johnson », Alpha History, consulté le [date d'aujourd'hui], https://alphahistory.com/vietnamwar/lyndon-johnson/.
