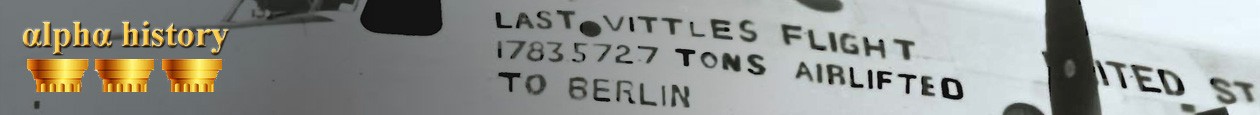Les tensions et rivalités de la Guerre froide se sont souvent manifestées sur la scène sportive. Comme pour la technologie et l’exploration spatiale, le sport est un domaine dans lequel les puissances rivales peuvent prouver ou affirmer leur domination sans entrer en guerre. Le sport pendant la guerre froide pourrait donc être hautement politisé. Les pays occidentaux et les pays du bloc soviétique ont investi massivement dans la formation et le développement du sport, en particulier dans les sports impliquant des compétitions internationales. Les Jeux Olympiques sont devenus l’une des principales arènes où se joue cette rivalité. Comme le Les nazis dans 1936, les superpuissances de la guerre froide ont cherché à exploiter les Jeux olympiques pour obtenir un avantage politique et idéologique. Les Jeux Olympiques ont accueilli de nombreux affrontements notables entre combattants de la guerre froide ; ces compétitions ont reçu une attention médiatique importante et quelques-unes se sont terminées de manière désordonnée ou controversée. Les Jeux olympiques ont également servi de théâtre à des protestations politiques, comme les boycotts controversés du début des années 1980. Le sport pendant la guerre froide pourrait également être constructif. Le sport sert parfois à briser la glace. L'intérêt pour le sport a fourni un terrain d'entente et une opportunité pour les rivaux politiques de communiquer et de nouer de meilleures relations.
L'Union soviétique (URSS) n'a pas participé aux Jeux olympiques d'été entre les deux guerres mondiales. L'URSS a été invitée à assister aux Jeux olympiques de Londres en 1948 mais a refusé, apparemment parce que Joseph Staline s'inquiétait du fait que les athlètes soviétiques n'étaient pas à la hauteur des normes mondiales. Moscou a lancé un effort intensif pour préparer les Jeux olympiques de 1952 à Helsinki, en Finlande. Cela a été validé lorsque l'Union soviétique a envoyé près de 300 athlètes à Helsinki et a remporté 71 médailles, dont 22 d'or. L'intérêt constant de Moscou pour le sport a porté ses fruits en 1956. L'équipe soviétique a dominé les Jeux olympiques d'hiver de 1956 en Italie, remportant 16 médailles. Les Soviétiques ont également terminé en tête du total des médailles aux Jeux olympiques d'été de Melbourne, en Australie, remportant 98 médailles (37 d'or). Il s'agit du plus grand nombre de médailles jamais remportées par une seule nation aux Jeux olympiques, éclipsant les 74 médailles des États-Unis (32 d'or). Les membres de l'équipe soviétique ont été salués comme des héros à leur retour de Melbourne ; 17 d’entre eux ont reçu le prestigieux Ordre de Lénine.

Moscou a continué à investir massivement pour assurer le succès olympique. Les athlètes qui remportaient des médailles olympiques ou battaient des records nationaux ou mondiaux se voyaient promettre des primes en espèces ou des récompenses en nature. Les installations sportives, les académies, les programmes d’entraînement et de formation ont tous reçu un financement public important. Entre 1960 et 1980, le gouvernement soviétique a investi massivement dans les infrastructures sportives, doublant le nombre de stades et de piscines et construisant près de 60,000 XNUMX nouveaux gymnases. Les sportifs et sportives à succès ont été célébrés dans la presse et la propagande d'État. Les citoyens ordinaires ont été encouragés à participer à des sports et les programmes sportifs sont devenus obligatoires dans les écoles soviétiques. Les programmes d'identification des talents ont repéré de jeunes athlètes prometteurs, à qui l'État a proposé un encadrement ou des bourses. L'Union soviétique a rejoint de nombreuses fédérations sportives internationales et est devenue compétente dans plusieurs sports, même ceux qui ont une histoire limitée en Russie, comme le basket-ball, le volley-ball et le football (soccer).
«Ce qui distingue les Allemands de l'Est du reste des athlètes du monde, ce n'est pas que certains (pas tous) ont concouru après avoir pris des stéroïdes, [mais que leur] programme était planifié. Il ne faut pas oublier l'importance de la culture physique obligatoire dans la vie est-allemande, le nombre considérable d'entraîneurs et d'instructeurs bénévoles hautement qualifiés qui ont travaillé dans le pays et la vigilance accordée à la recherche et à la formation de ceux qui ont un potentiel sportif.
James Riordan, historien
D'autres nations communistes ont réalisé des investissements similaires dans le sport. Allemagne de l'Est (DDR) accordait une grande importance aux prouesses sportives, motivées principalement par sa rivalité intense avec l'Allemagne de l'Ouest. Aucune des deux Allemagnes n'a participé aux Jeux olympiques de 1948, tandis que l'Allemagne de l'Est a boycotté les Jeux de 1952 après que le Comité international olympique (CIO) ait insisté pour qu'une équipe allemande soit unifiée. L'Allemagne de l'Est a envoyé sa propre équipe olympique pour la première fois en 1968, lorsque ses athlètes ont terminé cinquième au total des médailles, remportant 25 médailles (neuf d'or). Les Jeux olympiques de 1972, organisés à Munich, furent un triomphe pour les Allemands de l’Est. L'équipe de DDR a concouru dans 18 sports et a terminé troisième au total des médailles (40 médailles, 13 d'or) – 26 médailles d'avance sur le pays hôte, l'Allemagne de l'Ouest. Malgré sa population relativement petite (16 millions d'habitants), l'Allemagne de l'Est est devenue l'une des nations sportives les plus performantes des années 1970 et 1980, notamment en athlétisme, en natation, en aviron et en gymnastique. L'équipe est-allemande a terminé deuxième au classement des médailles, derrière l'Union soviétique, aux Jeux olympiques de 1976, 1980 et 1988 (comme l'URSS, l'Allemagne de l'Est a boycotté les jeux de Los Angeles en 1984). Les Allemands de l'Est ont également terminé premier ou deuxième lors de cinq Jeux olympiques d'hiver successifs. Le programme sportif est-allemand a ensuite été entaché d’allégations de dopage et d’utilisation généralisée de stéroïdes, même si peu de choses ont été prouvées.

Les Jeux olympiques de Melbourne (1956) ont été un exemple remarquable de tensions politiques qui se sont propagées dans le domaine sportif. Deux semaines avant la cérémonie d'ouverture, les forces soviétiques ont envahi Hongrie, a déposé le gouvernement réformiste de Imre Nagy et tué plus de 2,000 2 manifestants hongrois. L'équipe hongroise de water-polo a ensuite été tirée au sort pour rencontrer l'équipe de l'Union soviétique en demi-finale. Au cours de cette rencontre, surnommée plus tard le match « Du sang dans l'eau », les deux équipes ont échangé des insultes, des coups de pied et des coups de poing. Les tactiques brutales de l'équipe hongroise ont déstabilisé les Soviétiques, qui ont encaissé quatre buts sans parvenir à marquer eux-mêmes. Vers la fin du match, le joueur hongrois Ervin Zador a été frappé à la tête par son adversaire soviétique. Zador a quitté la piscine en saignant d'une entaille à l'œil et le match a été annulé à une minute de la fin. L'équipe soviétique a été huée et crachée par la foule australienne alors que les joueurs quittaient l'arène. La Hongrie s'est qualifiée pour la finale où elle a battu la Yougoslavie 1-XNUMX pour remporter la médaille d'or. L'équipe soviétique a dû se contenter du bronze.
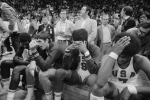
Un autre affrontement olympique notable a impliqué les équipes masculines de basket-ball des États-Unis et de l'Union soviétique aux Jeux olympiques de Munich de 1972. Les deux nations disposaient d’équipes puissantes avec de longs records de succès. L'équipe des États-Unis, alors composée de joueurs universitaires plutôt que de professionnels, avait remporté l'or aux sept Jeux Olympiques précédents. L'équipe soviétique était régulièrement médaillée d'argent olympique et championne d'Europe. Les équipes américaines et soviétiques ont été réparties dans des groupes différents à Munich. Tous deux ont progressé jusqu'à la finale avec une relative facilité, les Soviétiques battant Cuba et les Américains battant l'Italie en demi-finale. Le match pour la médaille d'or a reçu beaucoup d'attention médiatique, compte tenu de la force des deux équipes et des rivalités politiques de leurs nations. Les Soviétiques ont mené pendant la majeure partie du match, mais dans les dernières secondes, les Américains avaient riposté pour mener d'un point. Les erreurs et la confusion entre le chronométreur et les arbitres ont permis aux Soviétiques de transférer le jeu de leur côté et de marquer le panier gagnant. La victoire soviétique 51-50 a provoqué un tollé dans le camp américain, qui a affirmé que le jeu final était illégitime. Les responsables américains ont déposé une protestation infructueuse, puis un appel auprès du Comité International Olympique (CIO). Les joueurs américains ont refusé d'accepter la médaille d'argent, position qu'ils ont maintenue depuis.
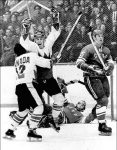
Les États-Unis n’étaient pas le seul pays occidental à entretenir une vive rivalité avec l’Union soviétique. En 1972, les diplomates canadiens et soviétiques à Moscou ont lancé une série de matchs de hockey sur glace entre les deux pays. Cette série de huit matchs, quatre dans chaque pays, s'est déroulée en septembre 1972. Initialement surnommée « Friendship Series », elle est devenue connue sous le nom de Summit Series. Sur le plan sportif, les Summit Series ont été un succès, produisant du hockey sur glace de haute qualité. Le Canada est entré dans la série comme favori, mais a été surpris lors de ses quatre matchs à domicile, traînant 2-1 contre les Soviétiques après quatre matchs. La série a suscité une intense couverture médiatique et a suscité un sentiment nationaliste des deux côtés. Sur le terrain, le match a été gâché par des allégations d'arbitrage biaisé, de tactiques controversées et de jeu de la part des deux côtés. Lors du sixième match, le joueur canadien Bobby Clarke a été accusé d'avoir délibérément blessé Valeri Kharlamov lors du sixième match, se fracturant la cheville. Le Canada a remporté la série 4-3, mais le niveau élevé des joueurs soviétiques a surpris leurs adversaires.
Les Jeux Olympiques sont parfois devenus une plate-forme pour les griefs politiques. Aux Jeux de 1968 à Mexico, la Tchécoslovaque Vera Caslavska - une gymnaste championne du monde et une critique Communisme soviétique dans son pays d'origine - a détourné la tête pendant la lecture de l'hymne soviétique. Chine communiste n'a pas été reconnu par le CIO et n'a donc pas participé aux Jeux olympiques d'été entre 1956 et 1980. L'équipe de la République de Chine (Taïwan) a boycotté les Jeux olympiques de 1976 après que le pays hôte, le Canada, a refusé de reconnaître sa souveraineté. Les boycotts olympiques les plus importants ont toutefois eu lieu dans les années 1980. En 1980, les États-Unis et plusieurs autres pays ont refusé d'assister aux Jeux olympiques de Moscou, en signe de protestation contre le L'invasion soviétique de l'Afghanistan. Au lieu de cela, les États-Unis ont accueilli des «Jeux olympiques alternatifs», le Liberty Bell Classic, auquel ont participé des athlètes de 29 pays. L'Union soviétique et 14 pays du bloc soviétique ont riposté en boycottant les jeux de 1984 à Los Angeles. Les Soviétiques ont également organisé leur propre carnaval alternatif, appelé les Jeux de l'Amitié.

Pendant la guerre froide, le sport était souvent conflictuel – mais il était parfois constructif. Il n’y a pas de meilleur exemple que le rôle du tennis de table dans la restauration des relations américano-chinoises. En 1971, les membres de l’équipe américaine de tennis de table effectuent une tournée au Japon et se lient d’amitié avec les membres de l’équipe chinoise. Les responsables chinois ont répondu en invitant l'équipe américaine à visiter leur pays. L'invitation fut acceptée et l'équipe américaine effectua une tournée en Chine en avril 1971. Cette visite, qui comprenait des matchs d'exhibition et des visites de la Cité interdite et de la Grande Muraille de Chine, suscita beaucoup de curiosité et d'attention médiatique dans les deux pays. Même si l’invitation a sans aucun doute été orchestrée par les dirigeants chinois, le tennis de table a servi de brise-glace diplomatique, permettant des démonstrations de confiance et de bonne volonté sans signes de faiblesse politique. Cette « diplomatie du ping-pong », comme on l'appelle désormais, a ouvert la voie à des visites et des réunions de plus haut niveau et, finalement, à un rapprochement entre la Chine et les États-Unis. Trois mois après la tournée américaine Secrétaire d'État américaine Henry Kissinger a visité la Chine pour des entretiens secrets avec Zhou Enlai. Kissinger a été suivi par le président Richard Nixon, qui a visité Beijing et rencontré Mao Zedong en février 1972. La Chine a ensuite été acceptée comme État membre des Nations Unies, tandis que Washington a rétabli les communications diplomatiques avec Beijing.

Les Jeux de la Bonne Volonté constituent un autre exemple de l’utilisation du sport pour panser les blessures de la guerre froide. Développés par le diffuseur américain Ted Turner et organisés par sa société Time Warner, les Goodwill Games avaient pour but d'apaiser l'acrimonie des boycotts olympiques de 1980 et 1984. Les premiers Goodwill Games, organisés à Moscou en juillet 1986, ont réuni environ 3,000 79 athlètes. de 1990 nations différentes. Ces matchs ont connu un franc succès, tant sur le terrain qu'en dehors. Ils n’étaient cependant pas sans problèmes politiques, Moscou interdisant les athlètes d’Israël et de Corée du Sud. Quatre autres Goodwill Games ont eu lieu : à Seattle (1994), à Saint-Pétersbourg (1998), à New York (2001) et à Brisbane (XNUMX). Ils ont ensuite été abandonnés en raison de la mauvaise audience de la télévision, du déclin de l'intérêt des athlètes, de la fin de la guerre froide et de l'amélioration des relations internationales. Malgré la perte de millions de dollars lors des Goodwill Games, Turner n'a exprimé aucun regret, affirmant que sa création avait joué un rôle central dans l'apaisement des tensions de la guerre froide.
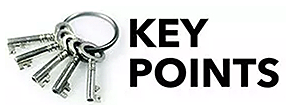
1. Pendant la guerre froide, de nombreux pays utilisaient le sport à des fins politiques ou idéologiques, par exemple pour démontrer la supériorité de leur système sur les autres.
2. Depuis la fin des années 1940, l’Union soviétique a beaucoup investi dans le sport en créant des infrastructures et des programmes visant à identifier, développer et former de nouveaux talents sportifs.
3. Ce financement public a porté ses fruits pour l'URSS lors de ses deux premiers Jeux olympiques. L'Allemagne de l'Est a suivi un chemin similaire et est devenue une nation sportive dominante dans les 1970.
4. Les tensions de la guerre froide ont alimenté certains affrontements olympiques controversés ou violents, comme le fameux match «Blood in the Water» entre les équipes soviétiques et hongroises de water-polo à Melbourne en 1956.
5. Le sport a parfois contribué à guérir les divisions de la guerre froide, en encourageant de meilleures communications et la bonne volonté. La «diplomatie du ping-pong» américano-chinoise (1971-72) et les Goodwill Games (1986-2001) en sont des exemples.
Le contenu de cette page est © Alpha History 2018-23. Ce contenu ne peut pas être republié ou distribué sans autorisation. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Conditions d’utilisation.
Cette page a été rédigée par Jennifer Llewellyn et Steve Thompson. Pour référencer cette page, utilisez la citation suivante :
J. Llewellyn et S. Thompson, « Le sport dans la guerre froide », Alpha History, consulté le [date d'aujourd'hui], https://alphahistory.com/coldwar/sport-cold-war/.